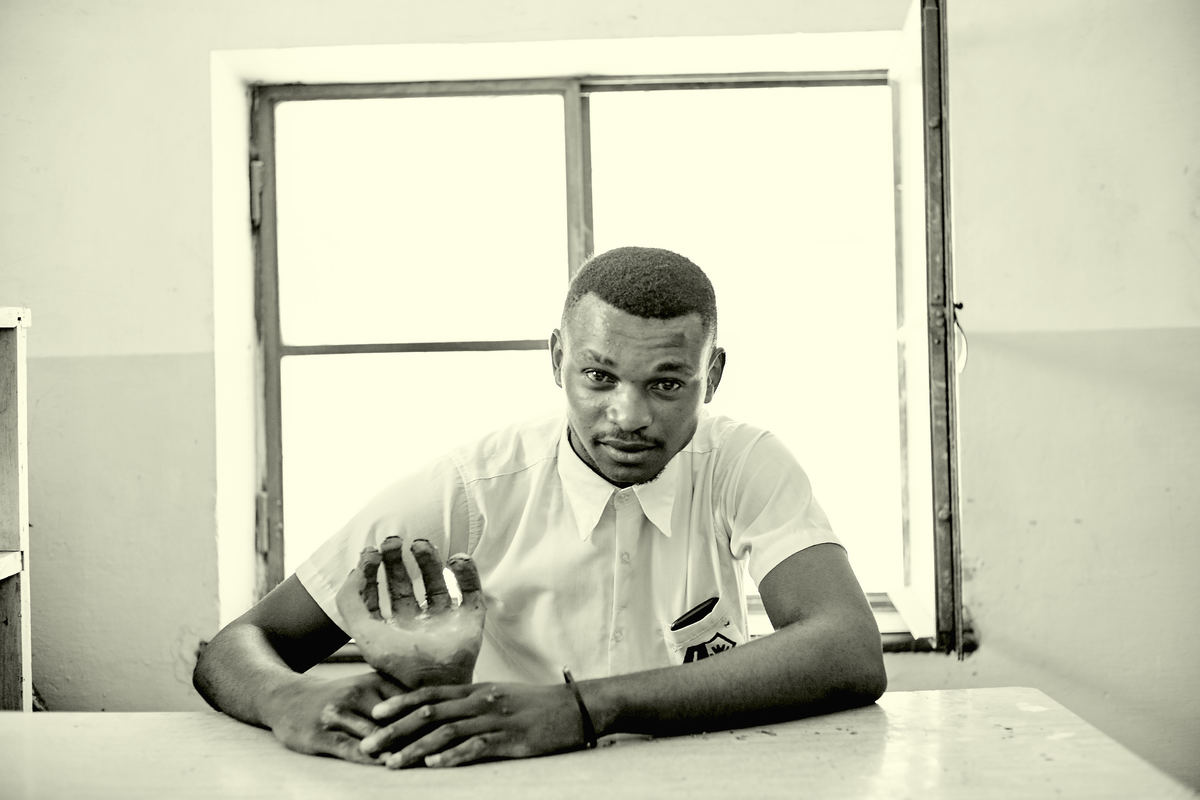Biennale de Lubumbashi: le pas vers l’ancrage
Door Sandra T.J. Coumans, op Thu Mar 29 2018 22:00:00 GMT+0000Comment construire une scène artistique indépendante? Pour ceux directement impliqués dans la Biennale de Lubumbashi en République Démocratique du Congo, il s'agit d'une question urgente qui a des conséquences sociales évidentes. En investissant dans son environnement local et en se forgeant sa place dans le monde, la biennale montre le chemin.
Nous sommes quelques personnes assises dans le patio de l'hôtel à Lubumbashi au Congo. C’est le début du mois d’octobre 2017, vers midi. Une partie des événements de la Biennale internationale de Lubumbashi est déjà lancée et pourtant, ce soir son inauguration officielle aura lieu au Musée National de Lubumbashi.
Quelques invités internationaux de la biennale se détendent une bière à la main et les discussions tournent autour des élections au Kenya. Nous sommes à quelques semaines d’un second scrutin général qui suit la décision de la Cour suprême du Kenya de déclarer les résultats des élections de début août comme invalides. L’atmosphère générale y est à l’incertitude, aux reproches, aux protestations, et on y déplore des blessés ainsi que plusieurs morts. Il n’en faut pas moins pour que la croissance économique stagne. Et en réalité, le pays vient d’être classé comme relativement stable sur le continent. Dans une frustration visible, l’artiste nairobien Thom Ogonga lance à travers le patio de l’hôtel : "Pourquoi faut-il encore que tant de pays africains gâchent tout !?".

Bonne question. Pourquoi de nombreux pays africain se retrouvent dans une spirale négative qui semble inéluctable ? Où est passé l’enthousiasme et l’énergie des jeunes leaders africains issus de la période des mouvements d’indépendance du siècle dernier ? Sera-t-il malgré tout possible de formuler une réponse positive à l’intensité de cette Histoire d’avant et d’après l'indépendance ?
Une biennale pour la ville
Comment un grand événement international de l'art contemporain est-il lié au contexte social et historique local ? Un engagement s'exprime-t-il principalement dans son positionnement artistique et de contenu ? Est-ce que les retombées économiques (une biennale internationale implique des visiteurs et donc des revenus) sont ce qu’un tel événement peut offrir de plus important au lieu qui l’accueille ? Ou existe-t-il d'autres interactions imaginables ?

En 2017, la Biennale de Lubumbashi, Rencontres Picha en est à sa cinquième édition organisée par Picha Asbl. Le projet de cette exposition d’art bisannuelle nait lors d’une visite à la Biennale de Bamako au Mali en 2007. Elle inspira entre autres l’artiste originaire de Lubumbashi, Sammy Baloji. C’est ainsi que nait l’organisation indépendante Picha – picha signifiant image en swahili – et que la première édition de la Biennale voit le jour en 2008.
Malgré les nombreux défis financiers et logistiques rencontrés au Congo, les organisateurs ont à nouveau réussi à mettre sur pied un événement d’art contemporain hétéroclite. Pour la deuxième fois sous la direction artistique de Toma Muteba Luntumbue, qui fait partie de cette diaspora congolaise au même titre que Baloji, Picha est en mesure de présenter une grande exposition internationale et multidisciplinaire d'art contemporain à ses concitoyens. Le projet n’est en effet pas à destination d’une élite artistique. L’objectif n’est pas d’intégrer avec cet événement le cercle des biennales d’art internationales telles que Venise ou Dak’Art. Au contraire, puisque l'art contemporain est aussi bon qu'absent à Lubumbashi, ils souhaitent le présenter à ses habitants et ainsi apporter une rupture – grande ou petite – avec le quotidien.
L’objectif n’est pas d’intégrer le cercle des biennales d’art internationales.
Le vernissage de l’exposition à l’Institut des Beaux-Arts Lubumbashi présente des artistes issus des écoles d’art de Lubumbashi et de Kinshasa et ne passe pas inaperçu auprès ses élèves. Tous très curieux, ils se mêlent aux invités présents. Le directeur artistique Luntumbue espère que l’art laissera une impression durable sur les jeunes, et que leur réalité en sera (inconsciemment) influencé et changé. Après tout, l'événement leur montre une alternative à la fois sur le contenu et au niveau professionnel, dans un pays où elle est largement absente pour la majorité des personnes.

Si la biennale apporte effectivement une contribution importante à la scène artistique publique de Lubumbashi et du Congo, inclure ces deux écoles d'art dans le programme leur donne un positionnement important au sein de cette même scène. C'est donc une légitimation de leur travail et de leur fonction. Et cela apporte aussi les ressources financières, qui autrement ne sont pas disponibles, pour réaliser les petites rénovations, toujours opportunes, à l'école. C’est ainsi que la biennale n'investit pas uniquement dans sa propre organisation, mais aussi dans l'avenir de son environnement immédiat.
Eblouissements critiques
Comme dans nombre de biennales d'art, Luntumbue présente l'art sur base d'une vision sociale globale. Le titre Éblouissements est une référence au livre L’impérialisme colonial. Critique de la société des éblouissements (2015) du sociologue Joseph Tonda. L’auteur y développe une critique de la société postcoloniale et la mondialisation à l’aire du capitalisme. Il évoque la violence de l’imaginaire qui s’exerce sur notre monde contemporain à travers ce qu’il nomme des éblouissements. Ces éblouissements peuvent signifier des émerveillements, des séductions, des fascinations, des aveuglements, ou même des états hallucinatoires.

Les idées de Tonda donnent dans le contexte de la biennale un moyen de proposer une réflexion critique d’une part sur notre réelle capacité à agir de façon autonome face aux multiples forces visibles et invisibles qui influencent le monde et, d’autre part, sur l’(im)possibilité d'une pratique artistique individuelle dans un monde saturé d'images.
C’est précisément cette friction entre le local et le global qui rend la proposition intéressante. Selon Luntumbue, il existe une certaine incohérence dans cet excès de visuels propre à notre époque. On peut d’une part, aisément affirmer qu’avec la globalisation et la numérisation de notre monde, les jeunes générations en particulier se basent sur un répertoire d’image de plus en plus homogène, et homogénéisent ainsi le langage visuel qu’ils utilisent. Par ailleurs, l’accès aux technologies fait de chacun un potentiel consommateur et créateur d’image.
Au-delà de l'omniprésence de la technologie numérique, l'endroit où vous vous trouvez physiquement fait malgré tout encore une grande différence.
D’autre part, Luntumbue observe que les différentes régions du monde offrent encore des différences importantes en termes d’intensité, de flux et quantité d’images. Si bien que, mêmes si les images sont de plus en plus identiques, leur exposition en est différente : d’autres quantité et débit. En outre, la possibilité d'interaction et d'échange via des images varie encore.
En résumé, au-delà de l'omniprésence de la technologie numérique, l'endroit où vous vous trouvez physiquement fait malgré tout encore une grande différence. Le concept d'éblouissements de la biennale pose alors clairement la question de savoir où vous êtes le mieux situé, sachant que plus vous êtes exposé à ce flot d'images, plus vous aurez de chances d’être piégé par ces états hallucinatoires.
Le regard quotidien
Avec son œuvre Upside Down Goggles de Carsten Höller présentée à la Biennale, la perception quotidienne est remise en question en offrant aux visiteurs une expérience déformant leur environnement. Ces lunettes futuristes qui recouvrent la majeure partie du visage et de la tête inversent le champ de vision immédiat. Le bas devenant le haut et inversement.

Le résultat est inattendu et la désorientation immédiate, à la fois drôle et dérangeante. L’artiste réussit son pari : les nombreux visiteurs de la Biennale qui essayent les lunettes commencent immédiatement à observer très attentivement leur environnement, mais ressentent aussi des vertiges et ont clairement du mal à se mouvoir. Et ils voient exactement la réalité telle que notre rétine la reçoit, avant que notre cerveau ait inversé cette image.
Dans une autre catégorie, mais tout aussi importante, on retrouve la sélection de peinture populaire congolaise, provenant de la collection unique du père Leon Verbeek – vivant à Lubumbashi – qui s'étend sur plus de 60 ans. Sur un mur large de pas moins de huit mètres, on découvre d'innombrables portraits de femmes, d'hommes, de couples, de familles et de dirigeants politiques. Les compositions sont simples, avec une palette de couleurs limitée, peintes sur du matériel bon marché et avec le tracé d’un cadre faisant office d’encadrement. Néanmoins, ces images dégagent une grande vitalité.

Elles font partie d'un genre populaire qui sert de conversation piece (ou « tableau de conversation »). Elles montrent à voir des événements d’actualité, des questions sociales, des personnes du cercle intime, des allégories. De cette façon, elles alimentent les discussions, provoquent des débats et remettent en question la société. C'est précisément leur volatilité et leur caractère local qui les rendent importantes : produites rapidement et en séries, elles sont financièrement accessibles et reflètent une histoire et une actualité communes.
Espaces captivants
La biennale de Lubumbashi est finalement un événement idiosyncratique, qui accorde beaucoup d'attention à la scène nationale sans pour autant perdre de vue le monde qui l'entoure. Elle est répartie sur cinq sites dans différents quartiers de Lubumbashi, cette métropole endormie qui doit son importance à son industrie minière.
Il y a d’un côté l'Atelier Picha où le coup d'envoi de la biennale a été donné avec des performances et un avant-vernissage. Il y a également le Musée National de Lubumbashi – qui abrite l'exposition principale – et l'Institut des Beaux-Arts de Lubumbashi. Enfin, la Halle de l'Etoile / Institut français et la galerie Hangar / Complexe La Plage présentent des expositions personnelles, une série de documentaires et de films, ainsi qu’une rétrospective.

Le programme riche et varié mêle des grands noms tels que Carsten Höller et Sammy Baloji avec des talents encore à découvrir, et met côte à côte des artistes congolais et d'autres artistes africains et européens tels que Kiripi Katembo Siku ou Jean-Pierre Bekolo.
Une vingtaine de professionnels venus de plusieurs pays d’Afrique et d’Europe participent également à la semaine d'ouverture. La plupart des Européens (Allemands, Belges, Espagnols, Italiens, Néerlandais) sont soutenus financièrement par leur université ou leur travail. Les Africains, venus entre autres de l'Angola, du Mozambique, du Sénégal, d’Afrique du Sud et du Rwanda, ont pu participer grâce à des bourses telles que Moving Africa, le programme d’échange panafricain mis en place par le Goethe Institut et dont l’objectif est de stimuler les réseaux de connaissance dans le secteur de l'art africain. Dans l’ensemble, la biennale offre un environnement et un rassemblement de gens fascinant qui n’auraient sans doute pas eu lieu sans le réseau étendu des organisateurs au Congo, en Afrique et en Europe.
Le bâtiment qui sert de bureau et de studio à Picha Asbl est l'un des endroits les plus inspirants de la biennale. C'est une maison agréable entourée d’un agréable jardin avec une petite maison de jardin. Au cours des derniers mois, une douzaine de jeunes artistes de différentes disciplines (photographie, danse, peinture, performance, vidéo, installation) venus des quatre coins du Congo en ont investi les différentes chambres et couloirs (voire même la rue). Ils y ont réalisé une résidence étalée sur trois mois, entièrement à l'invitation de l'Asbl. Le dispositif a été conçu intelligemment et guidé par de bons choix. La fin des résidences coïncidait en effet avec le début de la biennale, offrant par la même occasion aux artistes résidents un moment d’exposition (international).
Ce programme de résidence offre en outre un complément important à la modeste éducation artistique publique au Congo, en accordant une attention particulière au développement tant du fond que de la forme des artistes à travers un échange intensif avec des mentors et des animateurs de workshops locaux et internationaux. Les présentations sont de haut niveau. La plupart des œuvres dégagent un puissant langage formel propre à chaque artiste.
Revendication identitaire
Et c'est là précisément une des idées sous-jacentes de Picha : les participants sont sciemment encouragés à rechercher et à redécouvrir leur propre histoire congolaise, justement parce que les connaissances sont peu disponibles. Pour reprendre les mots de la coordinatrice de l’asbl Rosemary Tshawila, l’histoire c’est l'identité et l'identité donne de la stabilité. Elle y voit même un outil important pour le Congo en tant que pays pour vraiment prendre une nouvelle direction. Parce que sans conscience de son histoire, une personne ne pourra pas donner à la société. Reconquérir sa propre identité devient donc une reconquête de la société dans son ensemble.

Cet accent sur l'identité et sur la stabilité joue également un rôle essentiel pour Eddy Masumbuku. En 1996, il était, étudiant, l'un des trois inventeurs du Librisme, qui représente probablement plus un état d'esprit qu’un mouvement artistique. Il s'agit de la libération des influences externes (européennes) et de la quête identitaire de la personnalité jusque dans la méthode de travail de chaque artiste, alors que tout peut être le support de l'image. C'est en fait une revendication d'auto-développement artistique.
L'identité s’élaborerait selon lui aussi d'une manière sociale. Masumbuku considère que le rôle de l'artiste est d'être à la fois observateur et visionnaire. Dans son travail, un artiste doit faire le constat de la situation (sociale) telle qu'elle se présente, mais aussi y attacher une vision et émettre des propositions. Par ailleurs, l'identité fonctionnerait aussi comme un facteur stabilisateur, car elle assure une certaine continuité.
Enfin, cette quête identitaire à travers l'art, telle qu'elle est diffusée par le Librisme, conduirait également à une libération sur le plan spirituel. La confrontation entre l’idée et le matériau, c'est-à-dire le mouvement de l'abstrait vers l'objet, est une pierre angulaire métaphysique de la place de chacun dans le monde. Il faut en effet mener une réflexion spirituelle pour grandir en tant qu'être humain. C'est notre devoir dans la vie. Et, on peut le dire, une tâche que beaucoup de politiciens congolais n'assument pas selon Masumbuku.
Relier des mondes
À l'extérieur, le Musée National de Lubumbashi se démarque instantanément par sa forme imposante, celle d’un grand bloc de béton brut soutenu par des pilotis verts. C'est un bâtiment particulier mais disproportionné par rapport au terrain en friche et aux pavillons qui l’entourent.
Le concept de l'institution muséale est éminemment européen : le désir de documenter, d’archiver, de classer dans des vitrines sur base de catégories précises et définies.
A l’intérieur, le bâtiment se présente complètement différemment. Sur plusieurs niveaux, des couloirs, des escaliers et des ponts percés de baies relient entre elles des salles aux dimensions variables. Les œuvres sélectionnées pour la biennale côtoient et se mêlent aux objets de la collection ethnographique, archéologique et entomologique permanente du musée. Ces deux mondes qui restent généralement séparés entrent ici dans une dynamique complexe de contexte, d’origine, d’époque et de muséalisation.
Cette collection permanente a été initialement conçue sur un modèle européen et n'a pratiquement pas connu de changements depuis. De toute façon, le concept de l'institution muséale est aussi éminemment européen. Le désir de documenter, d’archiver, de classer dans des vitrines sur base de catégories d’objets et d’idées précises et définies.
Au-delà des musées
Babacar Mbaye Diop, ancien conservateur de la Biennale Dak'Art et professeur à l'Université de Dakar, a son propre avis sur le sujet. La question qui pour lui se pose sur le continent africain est de savoir comment créer sa propre modernité auto-déterminée ? Selon lui, ce n’est pas au moyen de musées, ethnographiques ou autres, car l'Afrique ne possède pas de culture muséale et n'en a jamais eu.

Qui plus est, la muséalisation signifie une perte de sens dans de nombreuses cultures africaines, car la valeur d'un objet réside dans son utilisation. Un masque qui n’est plus utilisé dans sa tradition rituelle est considéré comme un simple morceau de bois. Tout comme la peinture populaire congolaise sert de déclencheur de discussions, et n’est pas perçu comme un symbole de prestige.
C’est pourquoi le modèle de la biennale ou une variante se révèlerait une alternative extrêmement appropriée. Ce modèle offre la possibilité de créer une continuité dans une exposition et dans des rencontres artistiques sans avoir à recourir à une muséalisation. Et la Biennale de Lubumbashi se renforce particulièrement par l’échange avec l’autre. Par l'imagination artistique, elle enrichit la conscience collective de son contexte et de ses origines, sans se fermer au monde. C’est précisément là que se dessine cet important chemin vers l’ancrage de la société.
Elle utilise le local et les liens existants avec d'autres pays (africains et européens) pour renforcer sa propre scène artistique contemporaine et l’introduire à l’étranger. En outre, il existe un grand engagement social dans lequel la formulation et la réappropriation de l'identité jouent un rôle central. Une réflexion sur l'état du monde et de son propre environnement lui appartient presque naturellement, car ils sont inextricablement liés.
La biennale de Lubumbashi montre qu'il est important de trouver un juste équilibre entre l'international et le local, et de s'y positionner. Ce n'est certainement pas un défi auquel seul le Congo ou l'Afrique font face.